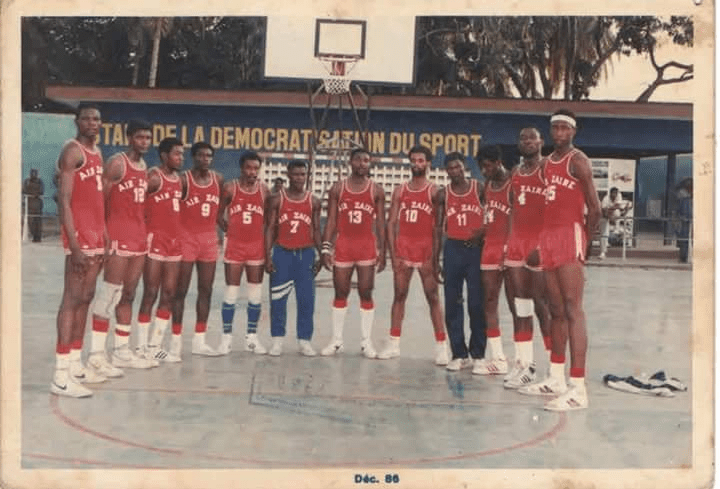Pour occuper les longues soirées d’hiver au coin du feu, Liège & Basketball vous propose la lecture, en découpage, d’un ouvrage de référence sur la Dream Team de Barcelone. C’est avec cette équipe incroyable que la popularité du basket et de la NBA a explosé au début des années 90. Le livre « Dream Team » écrit par Jack McCallum, éminente plume d’ESPN, nous plonge au coeur de cette équipe légendaire et de cette formidable épopée qui fête cette année ses 25 ans. Bonne lecture.
Chapitre 2 : L’Élu
C’était l’un de ces moments rares hors de la vue de Bob Knight, leur coach olympique tyrannique. Deux candidats à l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 1984, Michael Jordan et Patrick Ewing, profitaient de cette fenêtre de liberté pour chahuter dans leur chambre d’internat. Les défis sauvages de lutte dans les chambres étaient un dérivatif majeur pour ces étudiants, particulièrement Charles Barkley et Chuck Person, deux coéquipiers d’Auburn qui en étaient de fervents adeptes avant de tomber sous la coupe très stricte de Knight.
Jordan, qui venait de terminer sa troisième année à North Carolina, s’apprêtait à rejoindre la NBA, tandis qu’Ewing rempilerait pour une quatrième année à Georgetown. Ils étaient bons amis, s’étant déjà rencontrés lors de All-Star Games de lycée et, d’une manière plus concrète, lors de la finale NCAA 1982.
C’est à cette occasion qu’un tir extérieur du freshman Jordan donna définitivement l’avantage aux Tar Heels, 63-62, sur le freshman Ewing et les Georgetown Hoyas. Bien que personne ne le réalisât à époque, Ewing devint le premier de nombreux grands joueurs à se faire couper l’herbe sous le pied par Michael.
Un Jordan de 1,98 m tenait un Ewing de 2,13 m d’une clé de tête. Aucun des deux jeunes hommes n’était en colère mais cela ne voulait pas dire que ce n’était pas du sérieux : pour Jordan, tout ce qui revêtait un caractère compétitif prenait de l’importance. Finalement, Ewing dit le mot « uncle » pour signifier qu’il abandonnait. Et quand l’immense pivot se réveilla le lendemain matin, il ne pouvait plus bouger son cou.
Ça promettait de donner lieu à une explication houleuse.
« Coach, je ne peux pas participer à l’entraînement ce matin, dit Ewing en rassemblant tout son courage.
– Qu’est-ce qui t’arrive ? lui demanda Knight. »
Et Ewing fut obligé de lui déballer toute l’affaire, en désignant Jordan comme coupable.
« Donc, je suis resté sur le banc et Coach Knight est devenu fou, se souvint Ewing plus tard. Mais il n’en voulait qu’à moi seul. Michael ? Rien ne lui est arrivé. Il n’arrivait jamais rien à Michael. »
Oui, l’été 1984 fut glorieux pour Michael Jordan, le premier de beaucoup d’autres, malgré le fait qu’il avait été initialement réticent à se présenter à Los Angeles. « J’étais un peu intimidé par Coach Knight, me raconta Jordan à l’été 2011. Je n’aimais pas ses façons de faire. J’avais entendu dire qu’il maltraitait ses joueurs, qu’il les engueulait, et je ne voulais pas passer l’été à me faire enguirlander par quelqu’un. »
Donc, il demanda conseil à son coach, Dean Smith, avec qui il avait une relation de type père-fils, même si le propre père de Jordan, James, était un pilier dans sa vie.
« Coach Smith m’a dit que tout ce que Knight voulait voir, c’était les fondamentaux du jeu du basketball, poursuivit Jordan (même dans les conversations informelles, Jordan utilise l’expression « le jeu du basketball », comme s’il décrivait les Saintes Écritures). J’avais ces fondamentaux, donc ce n’était pas un problème. Et une fois que je me suis trouvé là-bas, j’ai vu un homme qui exigeait que vous jouiez d’une certaine façon et que vous ne fassiez pas la même erreur deux fois. Ce qui ne m’est pas arrivé. »
L’été fut glorieux, aussi, pour les gens qui dirigeaient le sport amateur aux États-Unis. Le boycott des Jeux de Moscou de 1980, qui les avait rendus amers envers le président Jimmy Carter, n’était plus qu’un lointain souvenir. Une solide équipe d’universitaires volontaires – emmenés par Jordan, dont les qualités singulières, si elles n’étaient pas connues du monde entier, étaient déjà reconnues aux États-Unis, où il venait de terminer une carrière universitaire dorée – était sur le point de déferler, à la conquête de la médaille d’or à Los Angeles. Quand les Soviétiques décidèrent de rendre la politesse de 1980 en boycottant les Jeux de L.A., cela ne semblait plus avoir beaucoup d’importance. Les universitaires américains auraient battu cette équipe de toute façon, ou du moins, c’était le sentiment général à l’époque.
Bobby Knight était l’archétype parfait sorti tout droit des manuels du basket universitaire, un tyran de tout premier ordre mais un gars du sérail, un disciple dévoué de l’Amateur Basketball Association of the United States (même s’il sortait parfois de ses gonds), l’organisation qui gérait le basket amateur à l’époque. « Avec Bobby aux manettes, me raconta C.M. Newton, l’un de ses assistants, il n’y avait pas de demi-mesure. C’était droit au but. »
Knight fit des sélections olympiques un exercice darwinien du début à la fin. Plus de cent joueurs furent invités et il en exclut vingt d’un coup. Karl Malone, un élément de Louisiana Tech très musclé mais complètement inconnu, se rappela que les premiers tris avaient quelque chose d’impersonnel. « Vous alliez faire la queue à la cafétéria, où ils avaient affiché une liste, me raconta-t-il. Si votre nom était dessus, vous étiez retenu. » Un jour, le nom de Malone n’a plus été sur la liste. De même, cette force de la nature appelée Charles Barkley a été évincée. Idem pour l’arrière appelé John Stockton.
Il y avait une partie du milieu du basket qui n’adhérait pas à Jordan quand il était à North Carolina où, d’après l’habituelle logique, le seul qui pouvait l’arrêter était Dean Smith, un fondamentaliste rigide dont les équipes devaient le plus possible se trouver en possession du ballon. Toute personne dotée de bons yeux et d’un cerveau en état de fonctionnement savait que Jordan allait être spectaculaire chez les pros ; mais une hypothèse était qu’il serait du type Clyde Drexler, ce produit de l’université de Houston qui venait de terminer sa première saison avec les Portland Trail Blazers – c’est-à-dire flashy mais parfois incontrôlable, un scoreur mais pas un shooteur, un chouchou du public mais pas une première option pour les coaches.
Bien que cette impression perdurât, chez certains, jusqu’en 1991, l’année où Jordan remporta son premier titre de champion NBA avec les Chicago Bulls, les connaisseurs qui suivaient les matches de Los Angeles virent le véritable potentiel de Michael. C’était un joueur qui pouvait faire éclater une zone avec son tir extérieur, étouffer un adversaire habituellement fort scoreur, assurer la mène s’il le fallait. Il pouvait « contenter » Bobby Knight, pour l’amour du ciel. « Les Jeux de 1984, me dit son agent David Falk, ont été sa révélation. »
Emmenés par Jordan, les Américains survolèrent la compétition olympique, remportant leurs huit matches avec une moyenne de 30 points d’avance. Ce faisant, ils rivalisèrent, en comparaison, avec la grande équipe d’Oscar Robertson et de Jerry West qui avait gagné la médaille d’or à Rome en 1960. Les États-Unis battirent le Canada en demi-finale et écrasèrent l’Espagne 96-65 en finale. Le nom de Michael était sur toutes les lèvres.

Il était devenu évident que Jordan était l’Élu et personne ne savait mieux que Falk, qui avait déjà entamé des négociations de sponsoring avec Nike, que cela changerait pour toujours la façon dont les athlètes seraient dorénavant sponsorisés. Jordan avait toujours porté des Converse, la chaussure choisie à la fois par son coach d’université et par le Comité olympique des États-Unis. C’était, de fait, le choix historique de la plupart des fans de basket. Michael a dit depuis que lui, comme de nombreux joueurs, pensait qu’Adidas faisait les meilleurs produits. Si une offre intéressante lui avait été faite, il aurait tout aussi bien pu signer avec Converse ou avec Adidas.
Cependant, Falk vit que Nike était plus « agressif » et plus pertinent, d’un point de vue marketing, que ses deux concurrents. Magic Johnson et Larry Bird, les deux plus grands noms du basket pro, portaient tous les deux des Converse. Mais la glorieuse firme, se reposant sur ses lauriers passés, ne fit presque rien pour eux. Arrêtons-nous un instant : Magic avait un surnom immortel, un sourire à 1 000 kilowatts, un jeu flashy, un lieu de vie très glamour et des titres de champion en pagaille. Pourtant, dans les premières années de sa carrière, Converse n’investit pas du tout sur son image, ce qui coûta des millions à Magic ainsi qu’à son sponsor. « Bien avant que Michael ne rejoigne la Ligue, me confia Falk, Magic aurait pu prendre possession du monde entier. »
Au contraire, chez Nike, des dirigeants tels que Rob Strasser virent en Jordan un nouvel horizon pour le jeu du sponsoring. De plus, Nike avait besoin de faire un gros coup car le boom des années 1970 s’était considérablement essoufflé. C’était une entreprise qui se flattait de savoir prendre des risques. Donc, elle décida de miser tout son budget marketing, 500 000 dollars, sur une campagne qui « vendrait » Jordan et de lui verser, en plus, des sommes substantielles pour qu’il porte des Nike. Malgré tout ça, Michael restait réticent envers Nike. Il n’avait jamais porté leurs chaussures et n’en savait pas grand-chose. La veille de prendre l’avion avec son père et David Falk pour se rendre au siège de Nike, à Beaverton, en Oregon, il dit à sa mère qu’il n’irait pas. Mais elle ne voulut rien entendre.
« Tu seras dans l’avion, Michael », dit Deloris Jordan. Et il fut dans l’avion.
Après cette première rencontre, Peter Moore, le designer en chef de Nike, montra à Jordan et à Falk des esquisses qu’il avait faites pour les chaussures Air Jordan, les survêtements, et des articles de prêt-à-porter, tous en rouge et noir – « les couleurs du diable », comme les décri- vit Michael à Falk. Jordan ne broncha pas, ne sourit pas, ne dit mot et tout le monde, dans la salle, pensa qu’il était subjugué. Après cette réunion, il admit qu’il avait été impressionné et ému ; et Falk négocia un contrat à 2,5 millions de dollars qui, comme tant de contrats au fil des années, était censé être la fin du monde. Ainsi naquit Air Jordan.
Au début, Jordan détestait ces chaussures rouges et noires. « Je vais avoir l’air d’un clown », disait-il. Mais il se radoucit et les porta. Ensuite, la NBA les déclara illicites pour d’obscures raisons, infligeant à Jordan 5 000 dollars d’amende par match, une somme que Nike paya en riant sous cape. Un compromis concernant le design fut finalement trouvé et la principale chose que ces amendes permirent fut de faire des chaussures de Jordan l’un des plus énormes coups médiatiques de la saison 1984-85, en focalisant l’attention du monde entier sur Nike.
Rod Thorn, le general manager des Bulls à l’époque, demanda à David Falk : « Qu’essayez-vous de faire ? Faire de lui un joueur de tennis ?
– Maintenant, vous l’avez », lui répondit l’agent.
Chapitre 3 – Le commissioner et l’inspecteur des viandes
La NBA trempe un timide orteil dans les eaux internationales. Fin 1985, le commissioner, David Stern, et son représentant, Russ Granik, ont reçu l’Inspecteur des viandes dans les bureaux new-yorkais de la Ligue. Le patron de la FIBA n’en croyait pas ses yeux. « Vous devez comprendre d’où je venais, m’a dit récemment Stanković à propos de cette réunion. C’était considéré comme presque criminel de simplement communiquer avec la ligue professionnelle. Dans le monde amateur, on n’était pas censés leur parler. Et je suis assis là, avec le commissioner, et nous avons une relation normale. » Il était franchement radieux à l’évocation de ce souvenir, comme Sally Field recevant l’Oscar de la meilleure actrice en 1984 et lançant son fameux « You like me ! ».
David Stern l’appréciait. Les deux hommes étaient attirés par le pouvoir, tout comme le sont les papillons par la lumière, mais ils avaient en commun ce quelque chose d’informel. Ce n’était exactement des gens normaux mais ils étaient suffisamment sensés pour savoir qu’ils devaient se comporter comme des gens normaux. Et Granik – avocat attentionné, calme et posé, qui était arrivé en NBA en 1976 – était le parfait complément de Stern, qui avait un tempérament fort, parfois volcanique.
Après les présentations d’usage, Stanković en vint directement aux faits. « Je ne crois pas en ces restrictions concernant qui devrait jouer et qui devrait ne pas jouer, dit-il. Les meilleurs joueurs du monde devraient pouvoir jouer partout, et même aux Jeux olympiques. Mais je ne peux pas le faire seul. »
Selon quelques théories révisionnistes, Stern – qui voit tout, qui sait tout – aurait instantanément saisi l’importance de s’aligner avec la FIBA, envisageant le jour où les joueurs de NBA deviendraient la crème du continent et où la Ligue inonderait l’Europe et l’Asie de baskets, de T-shirts et de sweats à capuche. Rien ne serait plus éloigné de la vérité et Stern, ce qui est tout à son honneur, n’a jamais prétendu le contraire. Ce n’est pas que l’idée de joueurs NBA aux Jeux fut renvoyée aux calendes grecques ; ce n’était même pas à l’ordre du jour.
Oui, Stern avait vu l’hypocrisie des règles – l’Allemand Detlef Schrempf, qui jouait en NBA pour environ 500 000 dollars par an, était considéré comme professionnel alors que le Brésilien Oscar Schmidt, qui jouait en Italie pour environ 1 million de dollars par an, était considéré comme un amateur éligible aux Jeux olympiques. Tout le monde voyait cette hypocrisie, sauf les coquilles vides qui dirigeaient l’olympisme. Cependant, le commissioner n’envisageait pas d’ajouter les Jeux olympiques à un calendrier déjà surchargé.
« David et moi pensions que le basket mondial entraînerait avec lui autant de charges que de bénéfices, dit Granik aujourd’hui. Et c’est ce que nous avons dit à Boris. »
Quoi qu’il en soit, quand Stanković évoqua une compétition réunissant une équipe NBA et quelques équipes FIBA, une sorte de premier pas, Stern répondit oui. « Nous l’accueillerons », dit-il immédiatement. C’est de cette réunion que naquit le premier Open McDonald’s, qui se tint à Milwaukee en 1987. Mais cela n’avait jamais été le projet de Stern de faire participer ses joueurs aux Jeux olympiques, en grande partie parce qu’il devait faire face à des problèmes bien plus pressants.
Le vent commençait à tourner au moment de la visite de Stanković mais la NBA était encore relativement fragile.
La blague populaire « Jusqu’où va la nullité de la NBA ? » est illustrée par les Finales 1980, retransmises en différé alors qu’un match au sommet opposait les Los Angeles Lakers (le rookie Magic Johnson, la superstar Kareem Abdul-Jabbar) aux Philadelphia 76ers (Julius Erving). Il y a d’autres indicateurs du faible poids de la NBA de l’époque. Quand Rick Welts fut embauché en 1982 pour diriger les opérations de sponsoring – « Comme tous les gars de David à l’époque, j’étais parfait pour le poste parce que j’étais jeune, naïf et pauvre », dit Welts aujourd’hui – la NBA n’avait absolument aucun business plan. Elle ne vendait rien à personne. Welts et les autres bons petits soldats, jeunes, naïfs et pauvres, se trouvaient dans un pays qui non seulement n’avait rien à faire de la NBA mais, en plus, la dénigrait ouvertement.
« La perception générale était que la NBA était mal gérée, qu’il y avait trop d’Afro-Américains, trop d’accusations de drogue, trop d’équipes en défaut de paiement, me confia Welts en 2011. Je contactais des annonceurs et c’était un miracle d’obtenir un retour quand on était rattaché au sigle NBA. La priorité était la NFL, la ligue majeure de baseball (MLB) et le sport universitaire. La NHL, quant à elle, passait bien avant la NBA. »
Tandis que sa troupe de jeunes commis bataillait au quotidien pour redorer l’image de la NBA, Stern cajolait et manigançait sournoisement en sous-main. « Le pouvoir des choses inlassablement répétées par tout le monde est quelque chose d’assez impressionnant… me dit Welts. Je rentrais à la maison complètement abattu après m’être fait jeter pendant douze heures et le téléphone sonnait à 22h dans ma chambre d’hôtel du Summit, sur Lexington Avenue. C’était David. Après 15 minutes, j’étais regonflé à bloc et prêt à repartir à la charge. »
Stern était si communément appelé « le meilleur commissioner sportif de tous les temps » qu’il s’est presque accaparé l’usage exclusif du terme. Mais il y a certainement eu une part de circonstances favorables dans son ascension. C’est sous sa coupe, après tout, que Michael/Magic/Larry sont descendus des cieux et à la fin de la journée, la seule chose qu’un homme de marketing puisse faire est de mettre un peu plus de lumière sur la scène. Si les gens n’aiment pas ce qu’ils voient, rien ne va se passer. Mais Stern et d’autres membres de son équipe ont trouvé comment valoriser au maximum le potentiel de ces joueurs et rentabiliser leur popularité.
Et alors même qu’il ne voyait pas complètement la voie qui se profilait devant lui, le commissioner garda toujours une oreille attentive aux sermons de l’Inspecteur des viandes, qui pensait que de grandes choses arriveraient si les États-Unis parvenaient à réunir leurs stars, les ficeler dans un beau paquet bleu, blanc et rouge et les envoyer jouer sur des terrains sacrés.
Chapitre 4 – La légende
« Je suis le roi du shoot à 3 points. » Le matin du 8 février 1986, Larry Bird était sur le parquet de la Reunion Arena, à Dallas, là où huit heures plus tard, il disputerait le premier concours de shoots à 3 points du All-Star Game de la NBA. Leon Wood, des New Jersey Nets, était là lui aussi. Il est aujourd’hui arbitre en NBA mais figurait parmi les favoris du concours à l’époque.
« Hey, Leon, lui dit Larry, t’as changé ton shoot dernièrement ? Il a l’air différent. »

Ça n’avait pas de sens, bien entendu. Mais Wood, dans sa deuxième année NBA, était réputé pour son shoot à 3 points – il n’avait pas peur de déclencher son tir plus d’un mètre derrière l’arc. Il eut l’air complètement paniqué. « Merde, si Larry Bird me dit que mon shoot a changé, je me demande si… »
Puis Bird commença à parler des ballons bleus, blancs, rouges, ceux qui valaient deux points (au lieu d’un) sur chacun des cinq présentoirs de cinq ballons qui avaient été installés pour la compétition. Bird dit qu’ils avaient l’air glissants. Wood sembla encore plus paniqué. Vous pouviez rayer Leon Wood des potentiels vainqueurs. Les autres verraient leur tour venir plus tard.
À ce moment-là – au milieu de la saison 1986 – Larry Joe Bird était le roi incontesté de la NBA. Il était bien parti pour remporter son troisième titre de MVP et ses Celtics étaient sur la route du titre NBA. Mais cela allait bien au-delà de ça. Ce fut l’esprit bravache de Bird, sa grande confiance en lui-même, sa verve moqueuse et goguenarde (son « trash-talk », comme disent les Américains, légendaire dans toute la Ligue mais que le grand public ignore, car Bird faisait du trash-talk de manière subtile), ce style de jeu « street » dans un enrobage un peu pataud, qui firent que la première moitié des années 1980 fut « son » jeu, « son » ère.
Les nombreux talents de Bird – l’adresse, l’opportunisme au rebond, la qualité de passe, la lecture du jeu, la combativité – étaient déjà à l’œuvre depuis son année rookie, en 1979-80. On a tendance à le voir comme un bourreau de travail, une machine à shooter qui s’était forgée depuis le lycée et à certains égards, il l’était. Mais c’était aussi un talent naturel, quelqu’un qui, comme il l’a admis, appréhendait le jeu avec une certaine facilité. Il le voyait tout simplement différemment de la plupart des autres personnes.
Bird savait très bien qu’à 29 ans et dans la septième année d’une carrière qui le mènerait au Hall of Fame, il n’y avait personne de son calibre. Et ce, malgré des problèmes de dos qui survinrent à l’été 1985, quand il pelleta du gravier dans la maison qu’il avait fait construire pour sa mère dans sa ville natale de French Lick, en Indiana. Dès le début de cette merveilleuse saison 1985-86, Bird eut parfois recours aux mains magiques de son physiothérapeute, Dan Dyrek, juste pour pouvoir quitter la position horizontale.
Un mois après le début de la saison, Dyrek était appelé dans la maison de banlieue de Larry. Il n’en crut pas ses yeux quand il observa Bird tenaillé par d’atroces douleurs. Cependant, son dos connut un répit – ça n’irait jamais vraiment en s’améliorant – et Larry put accomplir une autre saison transcendante.
Peu de temps après le All-Star Game, « Sports Illustrated » m’envoya écrire un article pour définir si Bird était, oui ou non, le plus grand joueur de tous les temps. Les magazines adorent ces histoires de « plus grand de tous les temps » – les hommes, en particulier, sont d’infatigables faiseurs de listes, prompts à perdre des heures et des heures en argumentaires enflammés pour savoir qui, de Keith Moon ou de John Bonham, était le plus grand batteur ; si « Taxi Driver » ou « Raging Bull » offrait son meilleur rôle à Robert De Niro.
De manière prévisible, je me suis pris au jeu et j’ai fait de Bird le plus grand joueur de tous les temps, relayé par plusieurs commentaires d’observateurs impartiaux, dont l’un était John Wooden. « J’ai toujours considéré Oscar Robertson comme le meilleur basketteur, me dit « le Magicien de Westwood ». Mais aujourd’hui, je ne suis pas sûr que Larry Bird ne le soit pas. »
A suivre…
– Jack McCallum, « Dream Team », éditions Talent Sport, sorti le 8 juin 2016, 396 pages, 22 euros et 13,99 en format numérique (Kindle)